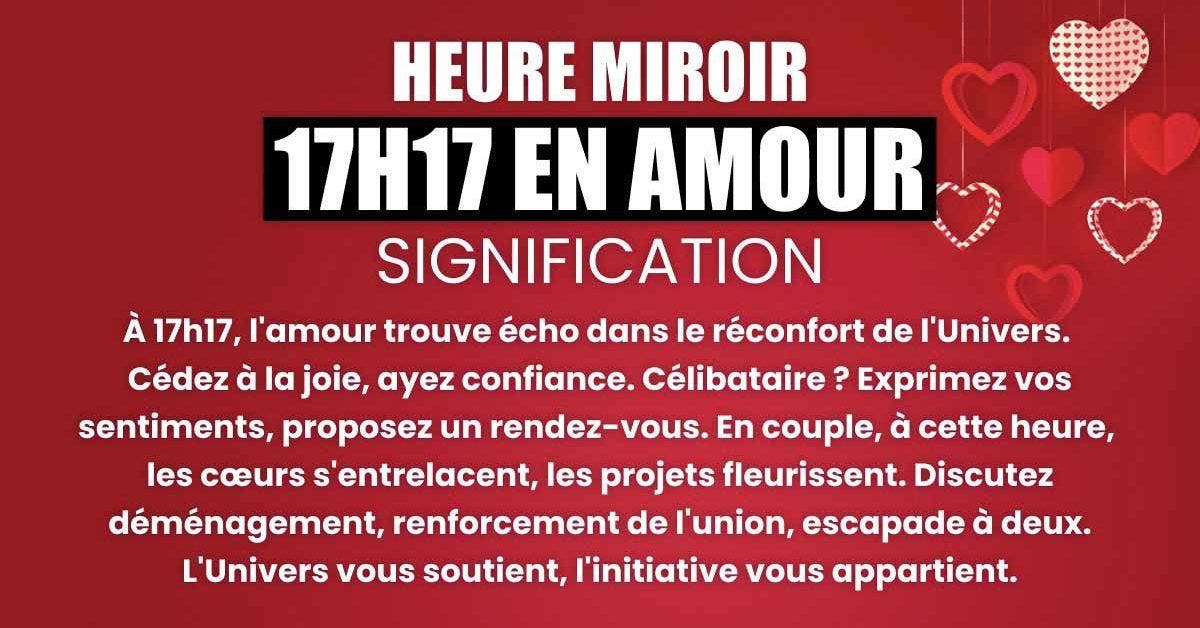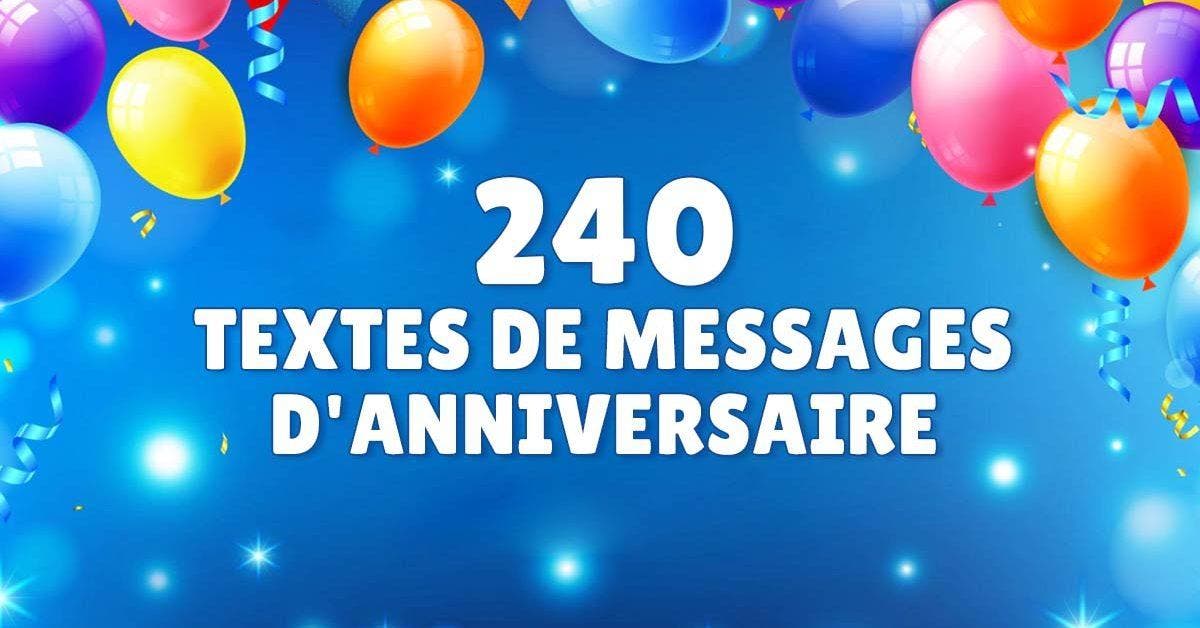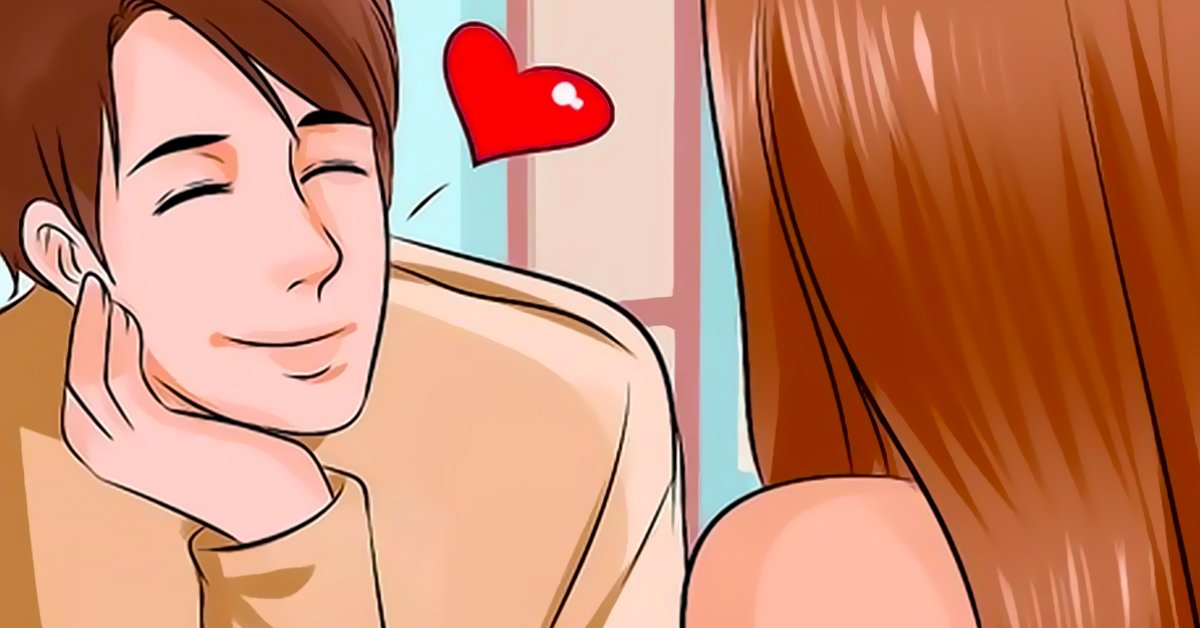Des kilomètres à parcourir… ou à renoncer
Prenons un exemple simple : un adolescent en détresse dans un petit village du Cantal ou des Hautes-Alpes. Un mal-être profond, des idées noires qui s’installent. Où aller ? À qui parler ? Souvent, le premier réflexe est d’appeler un centre médico-psychologique (CMP). « Encore faut-il qu’il y en ait un… et surtout, qu’il soit encore ouvert », observe Andréa Fernandez, psychologue clinicienne à Paris.
Dans certains départements, il faut faire plus de 50 kilomètres pour espérer croiser un psychiatre. Et ce, sans garantie de rendez-vous rapide. Ce n’est plus seulement une question de confort, c’est un véritable enjeu de santé publique. Car pendant ce temps-là, les troubles s’installent, s’aggravent. Et dans le pire des cas, mènent à l’irréparable.
Une pénurie qui dure, et s’aggrave
La désertification médicale, on la connaît. Mais en psychiatrie, elle prend une ampleur inquiétante. Dans les territoires ruraux, les praticiens se font rares, et les nouveaux diplômés, eux, s’installent dans les grandes villes, là où sont les CHU, les opportunités, les réseaux. « On ne peut pas leur en vouloir : les conditions de travail sont plus favorables, l’isolement est moindre, et l’accès à la formation continue plus simple », analyse Aurélie Lasserre, psychologue à Orléans. Résultat, la balance penche clairement du côté urbain.
Un chiffre suffit à résumer l’impasse : dans le Lot-et-Garonne, aucun pédopsychiatre n’est venu s’installer depuis Bordeaux depuis plus de 15 ans. Alors même que la demande, elle, n’a fait qu’augmenter. En cause ? Une centralisation toujours plus forte des études, et un système hospitalier qui peine à donner envie aux jeunes médecins de « monter en zone ».
Fermetures en série et patients sans solution
Autre symptôme inquiétant : la fermeture de structures. Ces CMP qui, pendant longtemps, ont fait office de relais essentiels dans la prise en charge de la santé mentale, ferment les uns après les autres. Dans les Vosges, celui de Bruyères a tiré le rideau en 2018. Motif ? Le départ du psychiatre… non remplacé. Les patients ont été « redéployés », comme on dit, vers d’autres centres déjà saturés, avec des listes d’attente de 130 à 150 personnes. Autant dire : une attente interminable pour des gens souvent à bout de souffle.
« Quand un CMP ferme, ce n’est pas seulement une structure qui disparaît, c’est tout un maillage de proximité qui se défait, et avec lui la possibilité d’un suivi régulier et précoce », alerte Aurélie Lasserre.
Cette situation crée une attente interminable pour des familles désespérées de trouver une aide adaptée pour leurs enfants. Et ce n’est pas un cas isolé. Le phénomène se répète dans l’Allier, dans le Gard, et dans bien d’autres départements ruraux où la fermeture d’un CMP pour enfants et adolescents (CMPEA) laisse des centaines de jeunes sans solution.
Quand le trajet devient un obstacle insurmontable
Même lorsque l’offre de soins existe, encore faut-il pouvoir s’y rendre. En zone rurale, il n’est pas rare de devoir conduire plus de 45 minutes pour consulter un psychiatre. Encore faut-il avoir une voiture. Les transports en commun ? Parfois inexistants. Les taxis conventionnés ? Pas toujours disponibles. Et les ambulanciers, eux, commencent à refuser les trajets jugés trop longs ou « non rentables ». Une réalité qui pousse certaines personnes à renoncer tout simplement à se soigner.
Et les visites à domicile ? Elles existaient, oui. Mais elles deviennent de plus en plus rares, faute de moyens humains et logistiques. Pourtant, pour beaucoup de patients isolés, c’était parfois le seul lien direct avec un soignant.
Des réponses innovantes… mais très inégales
Face à cette impasse, quelques initiatives émergent ici et là. Il faut bien combler les trous du filet, même avec des bouts de ficelle.
La télémédecine psychiatrique : une promesse en demi-teinte
On parle beaucoup de téléconsultations, notamment via des plateformes comme Doctolib, qui permettent en théorie de rapprocher les patients de praticiens éloignés grâce à son PC. Et sur le papier, l’idée semble pleine de bon sens : un écran, une connexion, et hop, un lien avec un spécialiste. Sauf que la réalité est moins fluide. Les populations concernées – souvent âgées, précaires ou en grande souffrance psychique – sont justement celles qui ont le plus de mal à utiliser ces outils.
Un essai avait été mené dans les Combrailles, entre un CMP local et les psychiatres du Centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Bilan : 80 téléconsultations en un an. Intéressant, certes, mais encore très marginal.
Des équipes mobiles… quand elles existent
Plus prometteuses, peut-être : les équipes mobiles de soins intensifs. Des professionnels de santé qui se déplacent directement chez les patients, notamment en cas de crise. On pense ici à « GEM ma Campagne », une initiative du GEM Cèzâme dans le Gard. Une trentaine de personnes suivies, un minibus pour les transporter… Une bouffée d’air dans un territoire enclavé.
Mais ces dispositifs restent fragiles, locaux, dépendants de subventions, de volontés individuelles. Loin de suffire à combler un besoin massif.
Des conséquences lourdes, pour tous
Ce manque d’accès aux soins psychiatriques ne reste pas sans effet. Bien au contraire.
D’abord, les troubles ne sont pas pris en charge à temps. Ce qui aurait pu être un épisode ponctuel devient chronique. Le diagnostic tarde, et quand il arrive, c’est parfois dans l’urgence, aux urgences psychiatriques, justement. Un détour évitable… s’il y avait eu un accompagnement en amont.
Ensuite, les taux de suicide restent plus élevés dans les zones rurales. Ce n’est pas une coïncidence. Isolement, absence de soutien, manque d’accès aux soins : Un soutien adapté pourrait alléger cette pression insoutenable et offrir une réelle bouffée d’air aux patients. le cocktail est explosif.
Et puis il y a ce tri cruel que doivent opérer les CMP encore debout : prioriser les urgences, repousser les autres. Dans les Pays de la Loire, on parle de délais de 4 à 6 mois pour un rendez-vous. Pour un suivi psychiatrique, cela revient à dire : débrouillez-vous en attendant.
Une urgence qui appelle une réponse politique forte
Il serait temps, vraiment, de considérer l’accès à la santé mentale comme un droit fondamental, peu importe le code postal. Encourager également la sensibilisation et l’éducation autour de la santé psychologique pour briser les tabous persistants. Cela implique d’investir, oui, mais surtout de repenser l’organisation : favoriser l’installation des praticiens, former localement, décentraliser les ressources, soutenir les structures itinérantes, et surtout… écouter les territoires.
« La santé mentale ne devrait pas être une loterie territoriale. On ne peut plus accepter que le lieu de résidence détermine la rapidité et la qualité de la prise en charge », insiste Andréa Fernandez.
Parce qu’au fond, ce que vivent ces zones rurales et montagneuses, c’est une double peine : géographique d’abord, mais aussi symbolique. Celle de ne pas être prioritaires. De devoir attendre. De devoir se débrouiller seuls, même dans les moments les plus fragiles.
Et cela, on ne peut plus l’accepter.